L’Histoire, le projet
L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public accompagne et diffuse les artistes dont les écritures font porter un nouveau regard sur les espaces publics. Elle apporte son soutien à chaque étape de la création de leurs spectacles : résidences d’écriture, de construction, de répétition.
Située au cœur de la zone Pahin de Tournefeuille, l’Usine fait le pari du rayonnement des arts de la rue sur les chemins qui créent notre quotidien, ordinaires au premier coup d’œil, mais rendus magiques par ces artistes qui le constituent.
Elle est aussi un lieu de création partagé, habitée par plus de trente corps de métiers, où depuis plus de 30 ans les spectacles s’écrivent, s’inventent et se construisent.
C’est en 1986 que des artistes, comédien·nes, musicien·nes, bricoleur·euses et créateur·rices d’horizons variés se regroupent et s’installent dans une ancienne usine d’équarrissage à Blagnac. Cette usine devient ainsi leur lieu de travail et de vie. Ils·elles partagent l’envie de faire sortir les spectacles des salles et de l’amener proche des gens, dans la rue.
Dès l’année 1994, l’Usine s’installe en location à Tournefeuille dans une ancienne menuiserie. Elle poursuit son désir de faire rayonner les arts en rue, gagne en visibilité, se professionnalise. Le bureau de production Les Thérèses rejoint l’Usine, Le PHUN est programmé dans le « IN » du festival d’Avignon avec le spectacle Les Gûmes, La Machine construit les géants pour le Royal de Luxe.
l’Usine signe alors sa première convention avec la Ville de Tournefeuille et le ministère de la Culture en 2002. À partir de 2005, c’est l’ensemble des partenaires publics qui sont signataires pour accompagner les missions de l’Usine : soutenir la création et la formation.
Grâce au soutien important de Toulouse Métropole et de l’ensemble des pouvoirs publics, un bâtiment pensé et adapté aux besoins de chacun sort de terre en 2008. Dès lors, les missions s’étendent aux projets de territoire, la diffusion, la sensibilisation des publics. Au regard de la place que prend l’image dans les esthétiques contemporaines, le studio d’animation La Ménagerie est invité à rejoindre l’Usine.
Jusqu’alors Scène Conventionnée arts de la rue, c’est avec le déploiement de ses activités artistiques, qu’elle reçoit en 2016 le label Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP).
Nos missions
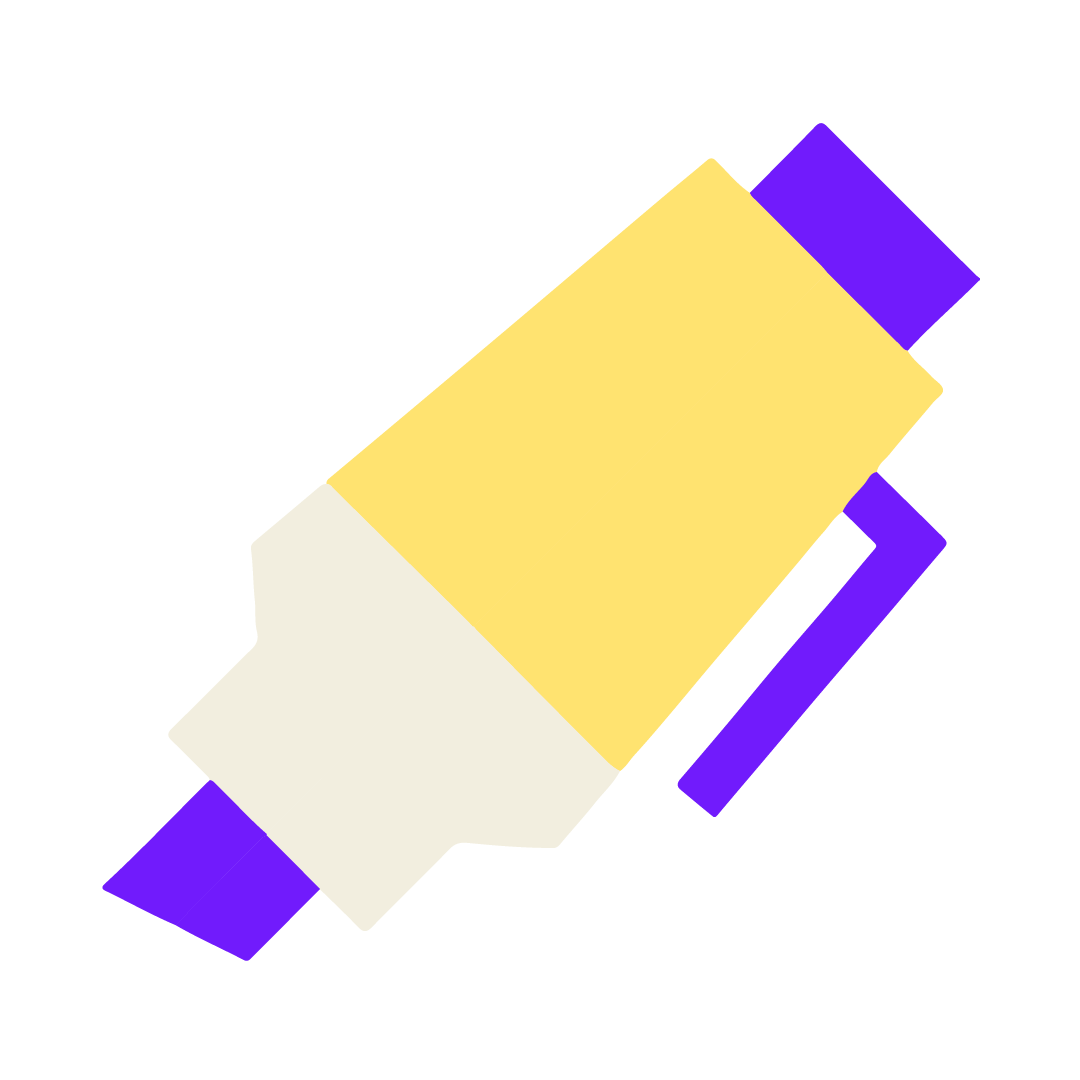
Le soutien à la création
l’Usine accompagne des compagnies tout au long de leur processus de création : écriture, répétitions, construction de décors, coproduction. Les espaces mis à leur disposition leur permettent de créer sur place et sur le territoire, et d’être hébergés grâce à “La maison” et au camping.
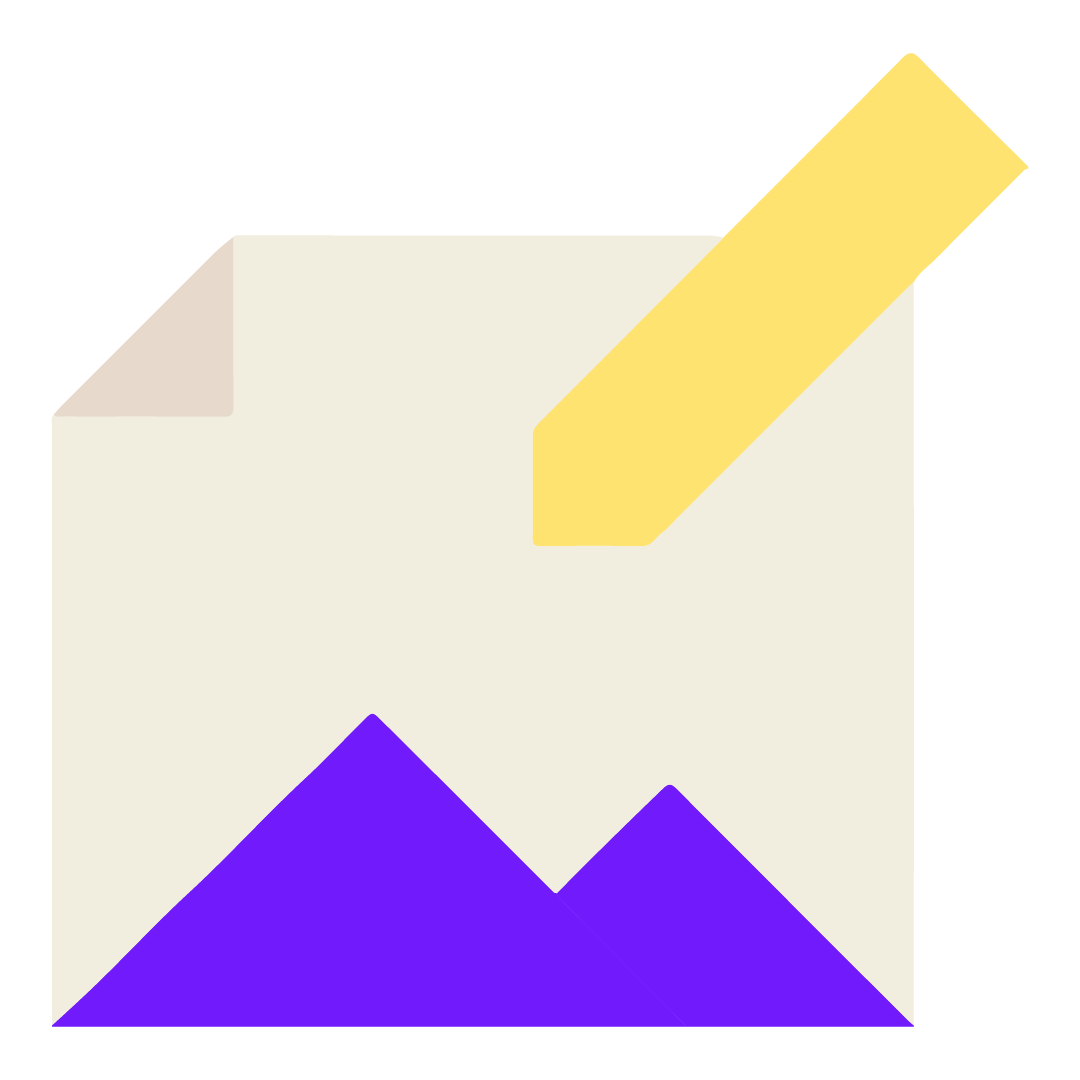
Les projets de territoire
Les projets de territoire de l’Usine visent à créer des opportunités de rencontres entre le processus de création artistique, les habitants et le territoire.
Les compagnies invitées sont soigneusement sélectionnées pour leur intérêt marqué envers les dimensions urbaines et sociologiques, explorant le territoire comme un champ d’expérimentation, de recherche et de création in situ. Leur participation contribue à renouveler les formes artistiques et les interactions avec les publics.
L’Usine offre ainsi aux habitants de la métropole toulousaine la possibilité d’explorer différentes facettes : en tant qu’habitant, acteur et spectateur. Chaque résident peut être sollicité dans le cadre de projets d’infusion, contribuant à nourrir la création artistique à partir de ses caractéristiques sociales, familiales, professionnelles et intimes, devenant ainsi acteur d’un projet artistique.
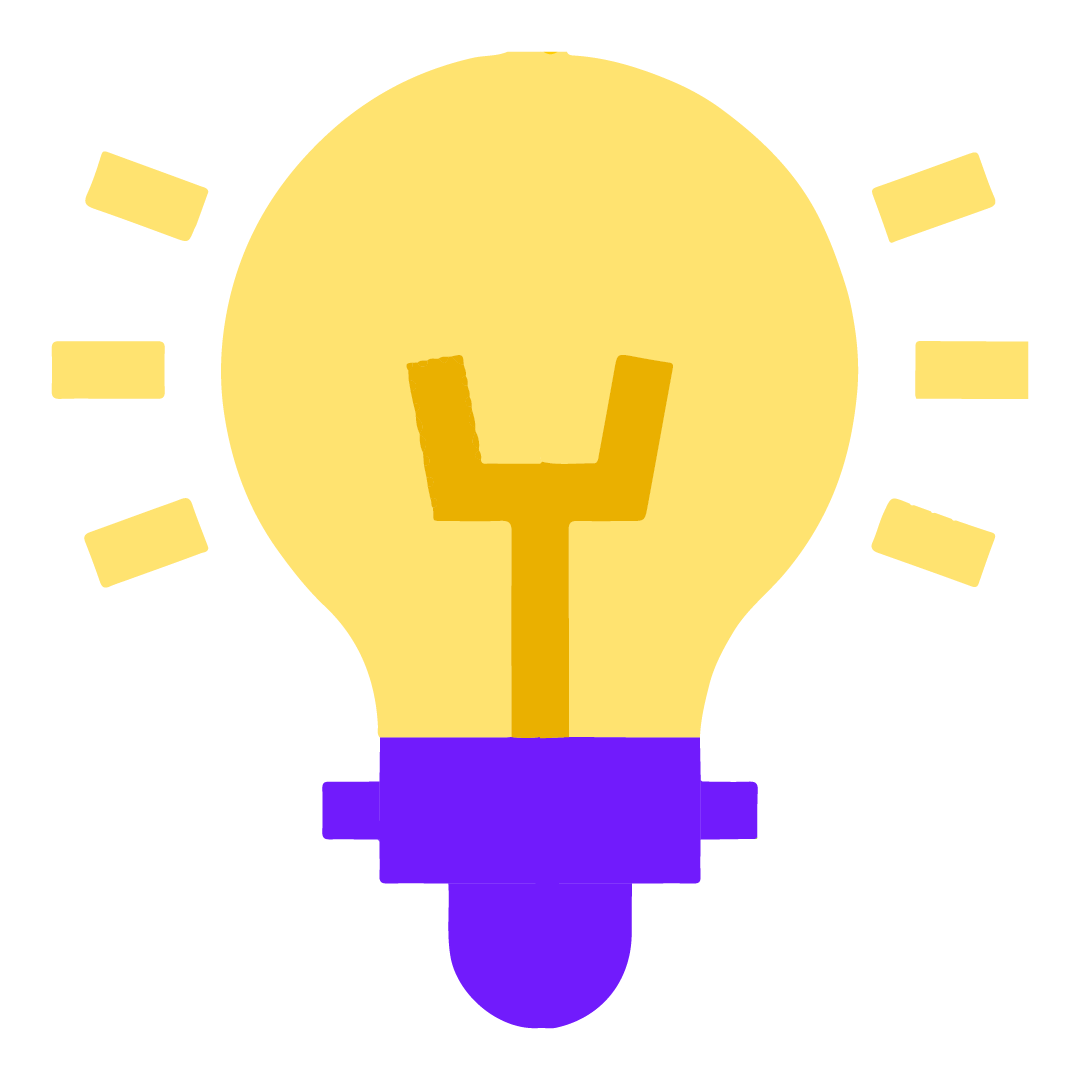
La diffusion
Considérée comme un prolongement de la création, la diffusion peut concerner des spectacles dont l’Usine a accompagné en amont le processus de création, on parlera alors de soutien à la création et de co-production. l’Usine programme plus de 50 représentations chaque saison – de septembre à juin – sur différents lieux en espace public. Cours, parcs, rues, piscines, places, terrains de sport… les lieux investis par les artistes changent en fonction de leur projet.
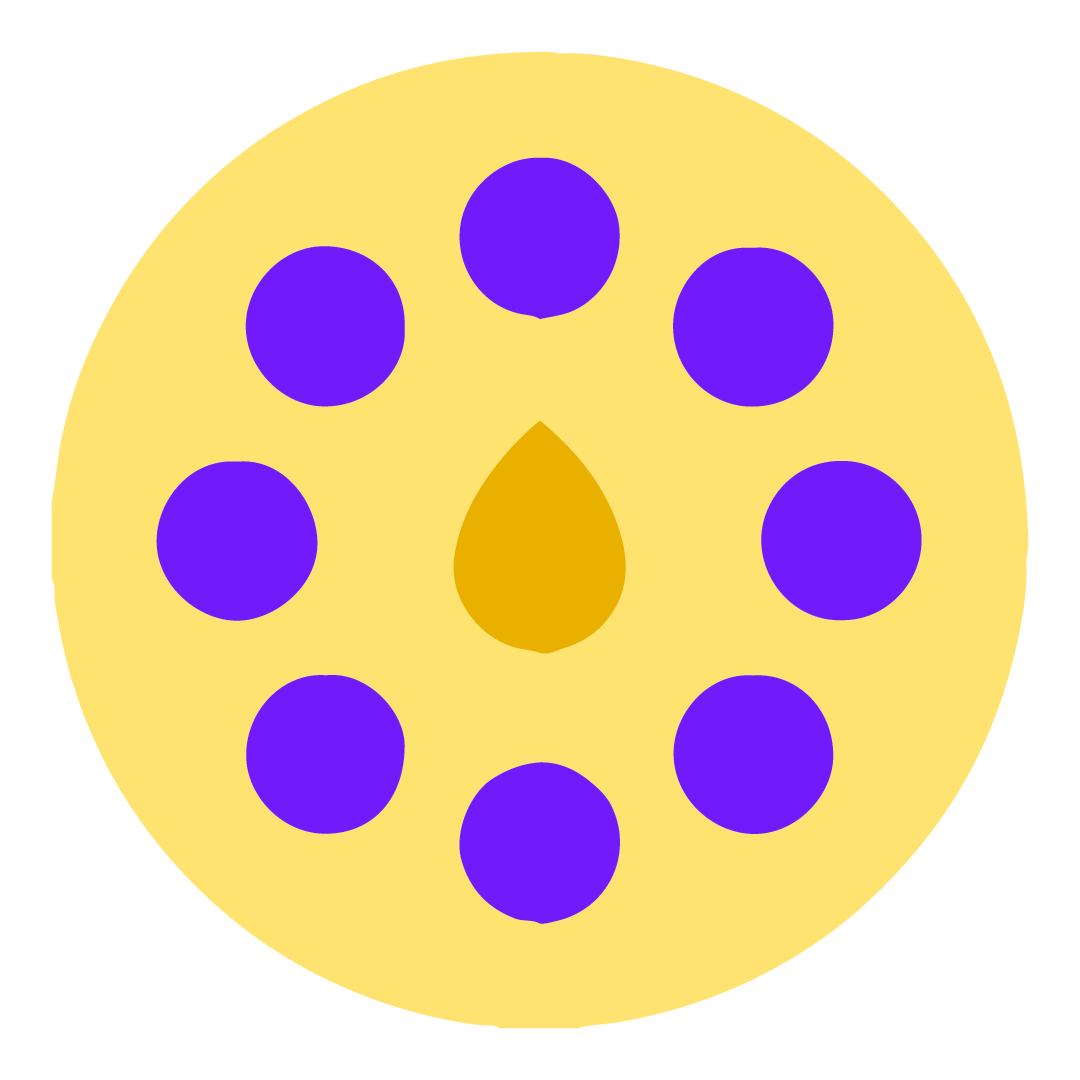
les actions d’éducation artistique et culturelle
l’Usine s’engage à rendre l’art et la culture accessibles à tous·tes sur le territoire métropolitain Toulousain. Un projet artistique et culturel qui se présente comme une passerelle vers l’ouverture aux autres et au territoire qui l’entoure.
Avec le développement de diverses actions de sensibilisation aux formes et aux esthétiques liant l’art à l’espace public nous invitons toutes personnes et toute structures à découvrir l’effervescence d’activités et de métiers qu’héberge l’Usine et qui n’attendent qu’à être partagées !
Le lieu, les espaces
Le bâtiment conçu par Toulouse Métropole a été pensé et adapté spécialement aux besoins de l’Usine pour permettre aux artistes en résidence de créer, d’innover et de construire dans des conditions confortables.
Il s’étend sur plus de 3500 m² et abrite :
- une vingtaine d’hébergements
- un bar-restaurant avec jardin
- une grande halle de construction outillée pour la fabrication de décors
- un atelier de couture et une costumerie
- la salle artivalente : une salle de répétition modulable en salle de spectacle pour accueillir le public.
S’y ajoutent des espaces investis de manière permanente par les quatre structures : La Machine, La Ménagerie, Le PHUN et Les Thérèses.
Vous souhaitez soutenir le projet ?
Devenez adhérent.e.s de l’association l’Usine CNAREP
Découvrir nos spectacles
Le spectacle de merde – Marion Duval
📆 ven. 13 et sam. 14 septembre à 19h30
📍 Ramonville – Festival de rue de Ramonville
Fête de rentrée de l’Usine
📆 sam. 21 septembre de 14h à 1h
📍 l’Usine, Tournefeuille
Care to Carry – Nick Steur
📆 ven. 27 sept. → sam. 12 oct. 2024 à 17 h
📍ThéâtredelaCité à Toulouse



